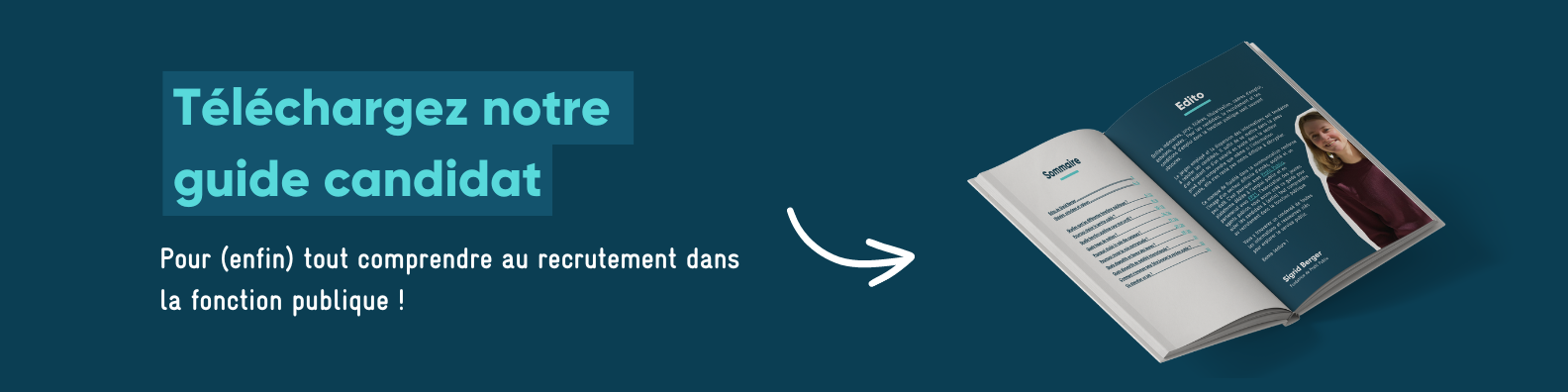« J’avais à cœur de travailler sur et pour un territoire. »
Lucie Vegrinne est responsable de l’animation du NéoLab, le laboratoire d’innovation territoriale des services de l’Etat de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes allés à sa rencontre pour vous faire découvrir ses missions et son regard sur les enjeux d’innovation publique.
.
SES MISSIONS AU COEUR DU SECTEUR PUBLIC
.
Votre parcours en quelques mots ?
J’ai suivi mon cursus universitaire à Sciences Po, entre Bordeaux et Paris, avec un fort attrait au départ pour l’ international. Mes premières expériences professionnelles m’ont ainsi conduite vers le développement urbain au Maroc, où j’ai travaillé sur un projet de participation citoyenne. Progressivement, mes études m’ont convaincue de l’importance de l’échelle territoriale dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. C’est pourquoi j’ai choisi de me spécialiser en master et d’entamer ma carrière sur l’accompagnement de projets à l’échelle locale, au sein d’une agence de conseil.
J’ai accompagné des collectivités, des opérateurs et des bailleurs sociaux dans la mise en place de démarches participatives, afin de co-construire des projets de territoire avec les usagers et un écosystème de partenaires. Cette expérience m’a également amenée à travailler sur des dynamiques de transformation interne, en lien avec l’évolution des pratiques culturelles et managériales.
À l’issue de cette première expérience, j’ai souhaité rejoindre une administration pour mieux en comprendre le fonctionnement de l’intérieur. C’est à ce moment-là que je me suis intéressée aux laboratoires d’innovation publique, ce qui m’a conduit à intégrer la Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine pour animer le laboratoire d’innovation territoriale “NéoLab”.
Votre métier et le cœur de vos missions actuelles ?
Le NéoLab est un laboratoire d’innovation territoriale interministériel réunissant l’ensemble des services de l’État en région Nouvelle-Aquitaine. Créé il y a un peu plus d’un an à l’initiative du préfet de région, il incarne une volonté de modernisation et d’expérimentation au service des politiques publiques.
Mon poste est rattaché au Secrétariat Général aux Affaires Régionales (SGAR), qui joue un rôle clé dans la mise en œuvre des politiques publiques et la gestion des moyens alloués à l’échelle régionale. Au sein du Lab, nos missions s’articulent autour de la mise en œuvre des politiques prioritaires du gouvernement. Il s’agit de participer à la fabrique de politiques et de services publics plus proches, plus simples et plus efficaces pour les usagers. Nous intervenons dès lors qu’il est utile de mobiliser l’intelligence collective pour dénouer un problème, de placer l’usager au cœur d’une démarche ou bien d’expérimenter une solution nouvelle.
En parallèle, nous accompagnons la transformation interne des services en participant à l’acculturation des agents à l’innovation publique sous toutes ses formes : facilitation, design, créativité, simplification, participation citoyenne, sciences comportementales,, mais aussi technologies émergentes, comme l’Intelligence Artificielle.
Pourquoi le service public ?
Étudiante, je ne me voyais pas encore rejoindre la fonction publique. Je pensais que le concours était un passage obligé. J’ai intégré le secteur du conseil, tout en travaillant toujours en lien avec le secteur public. Mais il était essentiel pour moi de m’engager au sein du service public, d’en comprendre les rouages de l’intérieur et d’en saisir les enjeux spécifiques.
J’avais également à cœur de travailler sur et pour un territoire, en m’inscrivant dans un écosystème d’acteurs et en y trouvant une sorte d’ancrage. C’est une approche qui a du sens pour moi. Et, au-delà de l’engagement, j’y trouve aussi un meilleur équilibre de vie.
Les grands défis de l’innovation publique ?
On pourrait penser qu’à l’heure des grandes transitions : démocratique, écologique, numérique ou encore sociale, et des contraintes budgétaires actuelles, peu de temps et de moyens peuvent être mobilisés pour l’innovation publique. Ce que je constate et ce que porte les Labs et la Direction Interministerielle de la Transformation Publique (DITP), c’est qu’au contraire il est urgent d’ouvrir des espaces de dialogues, de neutralité et de prise de hauteur. Il est nécessaire de créer du lien et de la confiance entre les citoyens et les institutions publiques. Nous avons besoin d’inventer de nouvelles solutions pour une action publique plus efficace.
Quels leviers pour innover dans la fabrique des politiques publiques ?
L’intelligence collective permet de concevoir les politiques publiques en collaboration avec un écosystème de partenaires territoriaux, dont les expertises complémentaires enrichissent la réflexion et éclairent les prises de décision.
La co-construction avec les usagers, quant à elle, repose sur une posture d’écoute et de compréhension fine des réalités du terrain. Elle permet d’adapter les politiques publiques et les dispositifs aux besoins concrets. Parfois, cela implique d’accepter d’être surpris par des retours collectés et d’adopter un regard neuf sur les usages, les vécus et les problématiques rencontrées.
Un projet dont vous êtes fière ?
En ce moment, nous collaborons avec la Direction de la coordination des politiques publiques de la préfecture de Gironde, qui pilote notamment le déploiement des Maisons France Services. Ces espaces, implantés au “dernier kilomètre”, offrent un accompagnement pour faciliter l’accès aux principales démarches administratives. Ce dispositif rencontre un réel succès : en Gironde, par exemple, chaque citoyen dispose aujourd’hui d’une maison France Services à moins de 20 minutes de son domicile et 96% des usagers sont satisfaits.
Cependant, ces structures restent encore méconnues de plus de la moitié des français. Par manque d’information, certaines personnes parcourent parfois une heure de route pour se rendre en préfecture, alors qu’une Maison France Services plus proche pourrait répondre à leur besoin. Notre mission consiste à mieux comprendre ces usagers : qui sont-ils ? Comment s’informent-ils et quels obstacles rencontrent-ils ? Comment mieux les orienter pour simplifier leur parcours ?
Ce travail repose sur l’immersion, l’écoute et l’échange avec les usagers, afin d’améliorer la visibilité du dispositif et d’optimiser son impact.
Nous développons également une démarche “d’aller vers” par les Maisons Frances Services pour mieux toucher les publics les plus éloignés : personnes en perte d’autonomie, qui habitent trop loin des emplacements des Maisons France Services, qui ne connaissent pas encore ce dispositif etc. Il s’agit d’imaginer des bus itinérants, d’organiser des permanences dans les mairies, de tenir des stands dans l’espace public… tout en accompagnant le changement que cela implique en termes d’organisation, d’équipement, de compétences, de partenaires, de maillage territorial. …
Une ressource pour creuser le sujet ?
Je conseille de jeter un œil au site de la Direction Interministerielle de la Transformation Publique (DITP) qui a également créé un Campus de la transformation publique avec de nombreuses ressources permettant de s’informer et de s’outiller sur ces thématiques.
Les Labonautes est un programme d’enquête-action porté par la 27e Région, le TiLab de Bretagne et la Direction Interministerielle de la Transformation Publique (DITP), visant à accompagner les laboratoires d’innovation publique dans leur structuration et leur impact. Il explore trois axes : éviter la dépolitisation de l’innovation, renforcer les capacités des labs et favoriser la collaboration. Ce programme regroupe plusieurs acteurs publics et académiques et permet de mutualiser outils et connaissances.
Enfin, le livre “Le Lab des Labs“, qui rassemble les contributions de 277 acteurs de Labs d’innovation, est un ouvrage très intéressant sur le sujet.
.